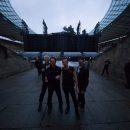Si le Brésil est loin d’être le seul pays à avoir compté dans sa vie riche et presque aussi aventureuse que celle des héros de ses romans, Jean-Christophe Rufin est apparu comme une évidence pour occuper le poste de président d’honneur du jury du premier Prix Choix Goncourt Brésil, remis la semaine dernière à Frère d’âme (Seuil, 2018), de David Diop. Bom Dia Brésil s’est entretenu avec l’auteur de Rouge Brésil (Gallimard, 2001) et La Salamandre (Gallimard, 2005) lors de l’étape carioca de son dernier séjour brésilien.
Comment s’est déroulée cette expérience avec les étudiants brésiliens qui ont décerné le Prix Choix Goncourt Brésil ?
C’est une très belle idée de l’académie Goncourt et cela a été très réussi, les étudiants se sont complètement passionnés pour cette mission. Pour eux, c’était très intéressant d’avoir à faire à des écrivains contemporains parce qu’on leur fait lire des classiques en général à l’université. Ils se sont rendu compte, et c’était le but, qu’il y a une création française qui est vivante et intéressante. Elle est inégale dans ce qu’elle peut leur apporter, mais ils ont très bien joué le jeu. Le livre de David Diop a été choisi à l’unanimité, il y avait un consensus au sein du jury et les débats n’ont donc pas été très violents. J’étais là pour faciliter la discussion, faire circuler la parole, que les étudiants expriment leur opinion et celle du groupe qu’ils représentaient.
Ce choix vous a-t-il surpris (le Prix Goncourt 2018 a lui été attribué à Leurs enfants après eux, Actes Sud, 2018, de Nicolas Mathieu) ?
Ce qui est le plus surprenant, ce sont les arguments qu’ils ont développés. Ils se sont beaucoup identifiés à la question coloniale et je suis toujours surpris que les Brésiliens puissent se sentir en symbiose avec une histoire, celle de l’Afrique, qui n’est pas du tout la leur, même si le Brésil aussi a vécu une histoire coloniale. Les tirailleurs sénégalais, ce n’est pas du tout leur histoire, mais les étudiants se sont sentis concernés, évoquant la négritude, leurs racines africaines, le fait qu’elles ont été niées. Je trouve cette identification néanmoins sympathique, traduisant une évolution et une prise de conscience chez les plus jeunes d’une identité plus multiple que leurs aînés, qui me semblaient plus dans le déni de tout cela.
Revenons sur votre lien avec le Brésil. Cela a commencé avec votre poste d’attaché de coopération et d’action culturelle au consulat général de France à Recife dans les années 1990. C’était un choix ?
Non, un hasard bureaucratique. Après avoir été dans un cabinet ministériel, j’avais souhaité faire de la coopération. Avec mon passé dans les ONG, on devait me nommer au Kenya, mais cela ne s’est pas fait, j’ai dû choisir de nouveau et parmi les postes disponibles, il y avait Recife. Je n’avais alors aucun lien et aucune connaissance du Brésil, j’ai tout appris sur le tas.
Au Brésil, j’ai eu l’impression d’arriver dans un pays de païens : la plage, le carnaval… Tout cela me paraissait incompréhensible à première vue. Il a fallu creuser pour trouver la spiritualité qui y existe.
Votre expérience n’a duré qu’un an et pourtant, le Brésil vous a inspiré deux livres par la suite. En quoi a-t-il été aussi marquant ?
C’était peu de temps en effet, mais c’était assez intense parce qu’en plus de l’apprentissage de la langue, j’étais complètement immergé dans un monde très brésilien. Puis des questions me sont venues. Ce pays me paraissait étrange. J’étais habitué à l’Afrique, l’Ethiopie en particulier, où il y a une spiritualité extrêmement à fleur de peau, tout le temps, partout, et au Brésil, j’ai eu l’impression d’arriver dans un pays de païens : la plage, le carnaval… Tout cela me paraissait incompréhensible à première vue. Il a fallu creuser pour trouver la spiritualité qui y existe.
Vous avez d’abord connu le Nordeste, mais votre premier roman brésilien, Rouge Brésil, paru en 2001, prend Rio comme décor…
J’avais commencé à lire, à rêver, à imaginer, surtout à chaque fois que je venais à Rio pour des réunions ou autre. Quand vous atterrissez en avion dans cette baie incroyable, si vous plissez les yeux, vous ne voyez plus trop les immeubles, uniquement le site, vous vous dites que les premiers navigateurs qui sont arrivés là au 16e siècle ont dû subir un choc encore plus grand. Petit à petit, en creusant, Jean de Léry, André Thevet, les historiens d’aujourd’hui, je me suis rendu compte de la complexité de cette affaire de la France Antarctique et notamment de son importance idéologique. Au départ, je pensais que les Français étaient arrivés dans du vide, c’était un peu l’image que l’on véhiculait jusque-là. On pensait qu’il n’y avait rien dans la baie et surtout personne. Or, il s’est passé quelque chose de décisif dans l’image que l’on peut se faire de l’autre, dans l’histoire des idées même, malgré un épisode négligeable puisqu’il n’a abouti à rien. Et comme je n’aime pas écrire d’essais, cela m’ennuie terriblement, j’ai raconté cela sous forme de roman.
A chaque fois que vous voyez cette Ile de Villegagnon, qui existe toujours, vous y repensez ?
Oui, c’est une histoire très poétique. Ce qui a déclenché chez moi l’envie d’écrire ce livre, c’est en réalité une image. Villegagnon avait sauvé Marie Stuart (lors de son départ pour la France en 1548, ndr) et les Ecossais, reconnaissants, lui avaient donné une garde. Il est donc arrivé à Rio avec des Ecossais. L’un d’entre eux jouait de la cornemuse et il emmerdait tout le monde. En arrivant dans la baie, le pauvre Ecossais a trouvé une baleine échouée sur le sable et il est monté dessus pour jouer de la cornemuse. Cette image m’a fait comme un déclic et j’ai écrit Rouge Brésil à partir de cela. Evidemment, ce ne sont que deux lignes dans le livre, mais il y avait tout : la singularité de l’histoire, sa poésie, le caractère universel de ces paysages…
Je ne pourrais ainsi vivre dans aucune des grandes villes brésiliennes. Si j’y vivais, elles perdraient leur qualité principale qui est de me faire rêver.
Vous vous sentez ainsi plus lié à Recife ou à Rio, ou à une autre ville brésilienne ?
Je ne me sens bien avec aucune à vrai dire, je me sens toujours profondément comme un étranger dans ce pays avec qui je n’ai ni familiarité ni hostilité. J’ai une grande sympathie pour le Brésil, mais je continue à ne pas y comprendre grand-chose. Je ne pourrais ainsi vivre dans aucune des grandes villes brésiliennes. Si j’y vivais, elles perdraient leur qualité principale qui est de me faire rêver. Par exemple, je n’ai jamais compris comment marchait São Paulo, on s’y perd, je n’y ai aucun repère, c’est une grande inconnue. Au contraire, Rio est articulée par son relief. En revanche, j’ai beaucoup d’intérêt et d’admiration pour Brasilia, qui est une expérience urbanistique formidable pour deux raisons : c’est un plan extraordinairement ambitieux et audacieux, et la manière dont ce plan, un peu totalitaire quand même, a été habité. C’est une ville passionnante.
Vous avez été élu le mois dernier à l’Académie brésilienne des Lettres pour occuper le siège de Jean d’Ormesson, décédé en décembre dernier. Vous connaissez la littérature brésilienne ?
Pas très bien. J’ai des idées assez sommaires sur la littérature en général et en particulier sur la brésilienne. J’ai lu Machado de Assis et quelques classiques, mais dans les contemporains, pas tant que cela, donc il va falloir que je me mettre un peu à jour ! J’ai été introduit à l’académie par mon ami Antônio Torres, qui a écrit en même temps que moi un livre sur cette expérience de Villegagnon, Meu Querido canibal (traduit en français sous le titre Mon Cher cannibale, éditions Petra, 2015, ndr), mais du côté des Indiens et du roi des Tupinambas, Cunhambebe. C’est intéressant car c’était une période où, tout d’un coup, à travers Antônio Torres surtout, on revenait sur le passé indien par opposition à la lecture portugaise de l’histoire brésilienne qui a quand même écrasé toute autre compréhension.
Justement, certains Brésiliens parfois se plaignent de cette colonisation portugaise et pensent que le Brésil s’en serait mieux sorti s’il avait été colonisé par les Anglais voire les Français. Qu’en pensez-vous ?
Quand j’ai publié Rouge Brésil, tous les Brésiliens m’ont posé cette question ! « Ah si on avait été français… » Je leur ai répondu que les territoires colonisés par les Français ne sont pas forcément de grandes réussites non plus. Je pense que le problème n’est pas le colonisateur, mais le fait colonial. Les Brésiliens ont l’impression que la France aurait nécessairement apporté les Lumières, etc. C’est vrai qu’elle avait cette ambition, c’était une idée de gauche en fait, Jules Ferry apportant la civilisation dans les colonies… mais la France leur a surtout apporté un coup de pied au cul ! Je disais donc aux Brésiliens qu’ils pouvaient l’imaginer si cela leur faisait plaisir, mais que s’ils avaient été colonisés par les Français, on ne leur aurait pas envoyé uniquement Victor Hugo et Emile Zola, mais aussi des gens plus ou moins bien intentionnés. Ils profitent mieux de la France en ayant ce rapport éloigné que de l’avoir eu à domicile tout le temps.
Ce qui me gêne, c’est cette façon que l’on a en France aujourd’hui de faire du Brésil une sorte de n+1 de tous les autres gouvernements conservateurs qu’on voit fleurir dans le monde. Autrement dit, on se fout de savoir les particularités du Brésil et on le met dans la même ligne qu'Orban, Salvini, etc. Il prête le flanc à cela, mais les Français aiment bien globaliser.
Enfin, quel est votre regard sur la situation actuelle du Brésil ?
Je ne suis vraiment pas un spécialiste et je ne voudrais pas avoir une parole d’autorité sur ce sujet, mais ce qui me gêne, c’est cette façon que l’on a en France aujourd’hui de faire du Brésil une sorte de n+1 de tous les autres gouvernements conservateurs qu’on voit fleurir dans le monde. Autrement dit, on se fout de savoir les particularités du Brésil et on le met dans la même ligne qu'Orban, Salvini, etc. Il prête le flanc à cela, mais les Français aiment bien globaliser. J’ai vécu cela en Ethiopie qui était considérée comme un pays communiste de plus alors que c’était tellement particulier, bien plus compliqué que cela. Même chose pour les printemps arabes. C’est une façon un peu trop simple d’écraser les réalités locales. Je pense que ce qu’il se passe ici n’a probablement pas grand-chose à voir avec ce qu’il peut se passer en Hongrie ou en Italie. Evidemment, il y a peut-être une résultante politique avec les thèmes du conservatisme, de l’ultranationalisme, une forme de xénophobie, mais j’ai l’impression que le socle de tout cela est complètement différent ici. J’essaye de le comprendre, je vois qu’il y a des composantes particulières comme ces églises évangéliques que j’ai vues monter. Tout le monde se foutait d’elles au début, mais elles ont construit au fil du temps quelque chose de très solide avec cette clientèle des favelas, cette action sociale de proximité, etc. Après il y a les militaires dont on a une idée assez décalée puisque je vois qu’ils jouent plutôt un rôle modérateur dans le système aujourd’hui, donc ce n’est pas Pinochet non plus, même si on ne sait pas s’ils peuvent devenir plus radicaux si les choses tournent mal. Et il y a toute cette corruption dont je n’arrive pas bien à comprendre comment elle fonctionne. Par exemple, Lula en prison, cela me surprend. Il a certainement commis des actes répréhensibles, mais je me demande si cette histoire n’est pas instrumentalisée à des fins politiques. Je n’ai pas l’impression que le bilan de Lula ait été si mauvais que cela, même s’il y a certainement eu une sorte de pourrissement du régime ensuite.